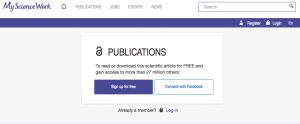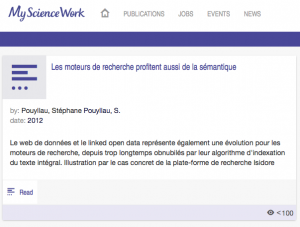Depuis quelques mois, je constate l’émergence d’une nouvelle « génération » d’historiens et historiennes. Il me semble qu’elle est apparue au détour des THATCamps sur les humanités numérique des années 2010-2012. J’y avais constaté la présence d’historiens et d’historiennes (et de nombreux doctorants et doctorantes) des disciplines de l’histoire moderne et contemporaine avides de comprendre le mouvement des humanités numériques. Plus attentif à porter mes deux communautés de formation (histoire médiévale et archéologie) vers les humanités numériques et surtout en raison de la création d’Huma-Num, je n’ai vu que récemment l’envol de cette une nouvelle « histoire à de l’ère numérique ». Si les historiens et historiennes ont depuis longtemps forgée des bases de données, gérés et utilisés des données quantitatives et qualitatives, il me semble qu’il souffle un vent un peu nouveau depuis quelques années en particulier sur trois points : la réflexion sur les méthodes de l’historien doublée une réflexion épistémologique assez poussée sur les sources de l’historien ; la place de l’outil (au sens large) dans la recherche et l’enseignement de l’histoire à l’université ; enfin, résultante de ce dernier point, le renouvellement des pratiques de l’enseignement de l’histoire dans le supérieur.
De nouvelles sources et un recul à prendre
Quand Frédéric Clavert utilise comme source de ses travaux des tweets, il fait entrer de nouveaux contenus (courts, liés à un contexte temporel, etc.) dans la bibliothèque du chercheur. Il y fait aussi entrer de la technique, de la documentation informatique, du code qui entraine obligatoire la nécessité d’une épistémologie des contenants au même titre que de celle des contenus.

Construire le réservoir de connaissance de l’historien à partir d’une API (ici celle de Twitter) implique une « diplomatique de l’API et du code » qui va traiter les données et une explicitation des choix qui seront fait par l’historien ou historienne des structures de la base de données. Même si de nos jours ce travail est mal pris en compte dans l’évaluation de la qualité des travaux, ce n’est qu’un moment. Demain, la « diplomatique de l’API » sera au centre de l’attention portée à compréhension des conclusions et connaissances nouvelles avancées par cette profession.
L’outil dans la recherche et dans l’enseignement
Quand Franziska Heimburger, Émilien Ruiz ou Caroline Muller diffusent leurs impressions, conseils, « trucs et astuces » et réflexions sur Zotero et autres outils, via leurs différents carnets de recherche, blogs, sites web, conférences, journées d’études, ils/elles placent l’outil numérique dans la recherche. Le programme informatique est dans leurs mains d’historiens et historiennes et c’est par leurs critiques et impressions qu’ils entrent dans le cartable de tous les futurs historiens et historiennes qu’ils/elles forment. Par leurs essais, pour leurs propres besoins, entourés (ou pas) de personnels d’accompagnement des SHS, ils/elles ont construit des protocoles du traitement des données de l’histoire. Ce n’est par la confrontation à la donnée et aux outils standards et finalement assez loin des grandes manœuvres, parfois un peu oppressante, de la normalisation et de l’internationalisation des pratiques par l’innovation, qu’ils/elles forgent leurs applications et leurs chaines de traitement des données.
Maintenant, ils/elles sont dans le partage de ces protocoles, ils/elles « prescrivent » et assument de le faire sans positionner ce savoir en tant que « science auxiliaire », c’est à dire à « coté » de l’histoire. Il me semble qu’il y là quelque chose d’intéressant. En effet, assumer d’être producteur de connaissance, forgeurs d’outils pour produire ces savoirs tout en assurant la critique, la promotion et l’enseignement de l’évolution des techniques de son propre métier — dans un domaine où l’on sépare encore largement le savoir érudit de comment il est produit, me semble relever d’une avancée considérable et d’une aventure passionnante. Car au-delà de l’important renouvellent les problématiques de recherche qu’ils/elles portent, ils/elles font évoluer les choses.
Enseigner à l’ère numérique
Quand Caroline Muller ou Martin Grandjean enseignent, ils intègrent dans leurs enseignements les méthodes et les (ou leurs) outils numériques. Ils modifient fortement et pour longtemps dans la façon d’enseigner l’histoire même si quelques retours en arrière peuvent être possibles malheureusement (sans doute dues à des contraintes passagères qu’à des réactions d’opposition construites et réfléchies).
Plusieurs billets ont récemment très bien détaillé je trouve cette appropriation du numérique dans les métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche en histoire : Emilien Ruiz l’a très bien exprimé dans “Historien·ne·s numériques : gare au SSPQ !” :
« Je suis, depuis longtemps, convaincu de la nécessité d’un ancrage disciplinaire de la formation numérique des étudiants : pour ne pas être dépendants des outils, pour se garder tant des envolées lyriques que des rejets dédaigneux, c’est en historiennes et historiens que nous devons appréhender les instruments informatiques et les ressources numériques à notre disposition. »
Le billet de Caroline Muller, “Le cours « de numérique » est un cours comme les autres” est aussi dans cette idée et va plus loin :
« Il était donc certainement nécessaire de passer par cette étape du champ séparé des « humanités numériques », même s’il a peut-être contribué, en retour, à instituer l’idée que c’est un monde à part, et retardé l’intégration aux pratiques et formations disciplinaires classiques. »
J’adhère à cette analyse.
Ces billets sont des marqueurs, bien visibles et pour une large audience, des transformations qui s’opèrent actuellement dans les parcours de L et M à l’université. En disant cela il me sera sans doute opposé l’idée qu’il s’agit là de parcours particuliers dus à la personnalité de quelques-uns ou quelques-unes, que ce n’est pas un mouvement de masse, que l’université n’est pas (ou n’est plus) en mesure d’en faire un enseignement pour tous, que les pratiques mettront 25 ans à changer, qu’il y a la question des moyens et de la formation continue du personnel enseignant post-recrutement, etc. Je sais tout cela.
Cependant je ne veux pas attendre que l’université s’y mette pour souligner l’importance du travail fait en ce moment par ces quelques personnes qui sont en train de faire évoluer sans pour autant être dans la « disruption ». D’autres me diront que du point de vue des métiers de la connaissance (documentation, bibliothèques, archives) cela n’est pas nouveau et qu’il y a encore beaucoup de travail. Je répondrai, tant mieux ! Cette évolution du métier d’historiens et historiennes que porte ce petit groupe vous permettra sans doute de faire évoluer les vôtres ! Cela faut d’ailleurs pour les sciences du numériques et la mise en oeuvre des infrastructures de recherche : délivrer de la « puissance numérique » doit tenir compte de ces évolutions et il faut éviter de plaquer des pratiques numériques issues d’autres communautés car — pour l’histoire, ces pratiques de l’ère numérique sont clairement en train d’être portées, d’être discutées par les enseignants-chercheurs du domaine. On fait un pas de coté, on observe et on accompagne.

Comme je dis depuis longtemps maintenant, faire de la recherche en SHS, depuis l’arrivée de l’ordinateurs (1972-1989), puis du Web (1989-), puis de l’ère numérique (que je fais débuter à l’arrivée des smartphones — en gros en 2007, et qui ont complété le carnet d’archives), c’est mixer les métiers. C’est faire à minima de 20 à 30% du chemin vers les autres métiers : de l’informatique, de la donnée, de l’archive. Le fait que ce mouvement irrigue en temps réel les enseignements est une chose importante car cela veut dire évidement que l’agilité et l’autonomie face aux données et aux outils s’améliore pour les historiens et historiennes, que la critique des méthodes et des outils se renforce et que les thématiques de recherche seront interrogées différemment.
En conclusion, si je me permets de mettre la lumière sur ces quelques personnes, pour certains et certaines croisés récemment, je le fais volontairement car il me semble qu’ils/elles sont plus assis sur la tête que sur les épaules des géants. Ce que je vois de cette évolution de l’historien me plait car elle place le numérique au bon niveau au bon moment. Surtout, le plus important à mes yeux, c’est que le bon niveau et le bon moment sont le fruit de leur travail mixant leurs pratiques et l’import de savoirs extérieurs (informatique, etc.) dans ce qu’ils/elles définissent comme le périmètre de l’historien/historienne.
Je veux par ce billet les remercier (eux et tous ceux qui ce placent de façon raisonnée dans l’ère numérique) d’avoir compris qu’il ne fallait pas forcement cultiver le champ qu’on leur destinait, et que pour cela il fallait mettre à jour leurs outils et la façon de les utiliser tout en s’imprégnant des travaux, des erreurs faites et des contraintes de leurs temps. Ils/elles sont des aussi des pionniers.
Stéphane Pouyllau.
Note : le billet contient sans doute encore des coquilles, merci de me les signaler en commentaire.